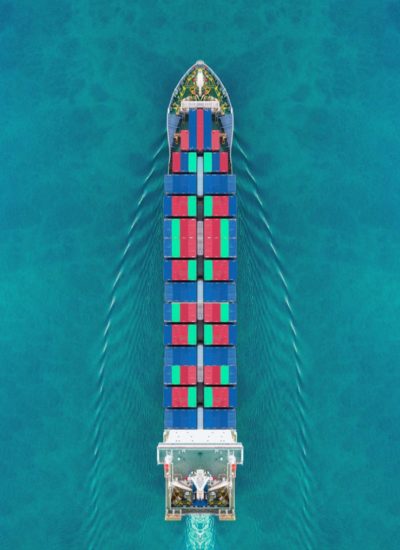Devoir de conseil du prestataire et obligation de coopération du client dans les contrats informatiques.
Par un arrêt du 5 juin dernier[1], la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer que le client d’un prestataire informatique est tenu de collaborer avec celui-ci, cette obligation de coopération faisant « nécessairement » partie du champ contractuel.
Dans cette affaire, une société qui diffusait, en particulier, des articles de sports sur internet avait confié la refonte de son site internet à un prestataire informatique. Par la suite, le client refuse de procéder au règlement du solde de la facture du prestataire en raison de prétendues inexécutions contractuelles.
Devant les juridictions du fond, le client sollicitait la résolution du contrat informatique et la restitution des acomptes versés au prestataire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence[2] refuse de faire droit à ces demandes au motif que le client n’avait pas répondu aux différentes demandes d’informations du prestataire et ce, alors même que les conditions générales de vente de ce dernier imposaient au client de collaborer activement[3].
Dans son pourvoi en cassation, la société cliente soutenait qu’elle n’était pas tenue à cette obligation de collaboration dès lors que le prestataire informatique ne démontrait pas lui avoir transmis les conditions générales de vente litigieuses sur lesquelles la Cour d’appel s’était fondée, de sorte que lesdites CGV ne pouvaient faire partie du périmètre contractuel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « la conception ou la refonte d’un site Internet exige la participation active du client tenu de fournir au prestataire les informations sans lesquelles celui-ci ne peut mener à bien sa mission, ce dont il résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel. »
En d’autres termes, pour la Haute juridiction, l’obligation de coopération est inhérente aux contrats informatiques et s’impose, en toutes circonstances, aux parties de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit expressément stipulée dans les documents contractuels du prestataire informatique.
Si la Cour de cassation ne précise pas le fondement de ce devoir de collaboration, il n’est pas impossible qu’elle fasse, ici, implicitement application de l’article 1194 du Code civil lequel prévoit que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature. »[4]
Cet arrêt est l’occasion de rappeler les obligations de conseil et de coopération qui pèsent sur les acteurs des contras informatiques.
1. Les obligations pesant sur les prestataires informatiques
- L’obligation d’information précontractuelle
Cette obligation figure désormais expressément à l’article 1112-1 alinéa 1er du Code civil qui dispose « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant – sauf, selon l’alinéa 2, en ce qui concerne « l’estimation de la valeur de la prestation ».
En matière informatique, ce devoir impose au prestataire de fournir au client toutes les informations nécessaires et utiles pour lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause et qu’il pouvait, compte tenu de ses compétences en la matière, légitimement ignorer. Il s’agit donc d’un devoir précontractuel d’information circonscrit à des informations portant sur le contenu et le matériel objet du contrat et nécessaire à la bonne compréhension du client.
L’obligation de conseil est, quant à elle, plus exigeante en ce sens que le prestataire se doit de se prononcer sur la solution la mieux adaptée aux besoins de ses clients, voire même de déconseiller à ces derniers les solutions inadéquates. Pour ce faire, il appartient au prestataire de se renseigner et de s’informer sur les besoins et la volonté de ses clients, y compris lorsque ces derniers sont des professionnels.
Il convient de souligner que cette obligation de conseil est de résultat quant à la réalité de la délivrance du conseil[5] mais est, en revanche, de moyen quant à la teneur et à la pertinence des conseils donnés[6]. Dans le premier cas, la responsabilité du prestataire sera engagée par la simple démonstration, par le client, que le conseil ne lui a pas été délivré. Dans le second cas, la responsabilité du prestataire ne sera retenue qu’à la condition que le client démontre une faute de son cocontractant laquelle pourrait être caractérisée par la délivrance d’un conseil erroné.
A titre d’exemple, les juridictions du fond ont pu condamner le prestataire informatique pour manquement à son obligation de conseil :
- lorsqu’il n’informe pas le client sur les spécificités et limites du produit ou sur la complexité des développements logiciels spécifiques à réaliser et ce, même si le client exerce une activité dans le domaine informatique[7];
- lorsqu’il n’a pas procédé à une étude suffisante des besoins de son client et lui a fourni des progiciels inadaptés à son activité[8];
- lorsqu’il n’informe pas son client sur les limites de sa prestation et les fonctionnalités limitées du logiciel vendu[9].
Le devoir de conseil peut également impliquer pour le prestataire une obligation de mise en garde visant à alerter le client sur les dangers que représente l’opération envisagée ainsi que sur les éventuelles contraintes techniques de celle-ci.
2. L’obligation de coopération du client
L’obligation d’information et de conseil du prestataire a pour corollaire une obligation de collaboration et de coopération du client consacrée par la jurisprudence[10] et en vertu de laquelle le client doit fournir au prestataire les moyens nécessaires à la parfaite exécution du contrat informatique.
Pour apprécier la conformité de l’exécution de la prestation informatique, la qualité de la prestation doit être regardée différemment selon que le client a ou non collaboré à son résultat. Si l’exécution n’est pas conforme en raison de l’absence de collaboration du client, cette non-conformité pourra, en principe, ne pas être imputée au prestataire.
Cette obligation de collaboration et de coopération du client intervient au stade de la négociation du contrat mais également pendant l’exécution du contrat.
Ainsi, lors de la négociation du contrat, le client doit notamment recueillir toutes les informations utiles concernant la prestation informatique souhaitée et préciser ses attentes[11], spécifier les objectifs précis à atteindre[12].
Lors de l’exécution du contrat, le client doit faire preuve d’une implication suffisante dans la réalisation de l’opération informatique, indiquer les spécificités de fonctionnement de son entreprise[13] ou mettre en mesure le prestataire de respecter les délais contractuellement prévus[14].
Reste que le degré d’intensité de l’obligation d’information du prestataire et de l’obligation de coopération du client variera en fonction des connaissances et des compétences de ce dernier.
En effet, lorsque le client est considéré comme profane en informatique ne disposant d’aucune compétence en la matière, l’obligation d’information du prestataire sera renforcée et l’obligation de coopération, quant à elle, atténuée[15].
S’il résulte de l’arrêt commenté que l’obligation de coopération s’impose au client, nous conseillons toutefois aux prestataires informatiques de rappeler systématiquement à leurs clients l’obligation générale de collaboration dont ils sont débiteurs mais également, de préciser les contours et l’intensité de cette obligation afin d’éviter d’éventuelles difficultés qui pourraient survenir dans l’exécution du contrat.
A titre d’exemple, il peut être demandé au client de fournir tout document nécessaire à la parfaite compréhension de ses besoins par le prestataire, de désigner un interlocuteur privilégié, d’assurer au prestataire un libre accès à ses locaux nécessaire à la bonne exécution du contrat, de participer de manière active à l’élaboration du projet informatique et surtout de participer à l’élaboration d’un cahier des charges précis.
Le cabinet peut vous accompagner dans la rédaction de vos contrats informatiques.
Morgane LE LUHERNE – Thomas ZANITTI
Avocats – Département Droit économique – Droit de l’informatique
[1] Cass. Com, 5 juin 2019, n°17-26.230
[2] CA Aix-en-Provence, 22 juin 2017, RG n°14/15881
[3] L’article 5 des conditions générales de vente du prestataire était rédigé ainsi : « Il collaborera avec le prestataire en vue d’assurer la bonne exécution du contrat, notamment en y allouant les moyens et le personnel nécessaire en répondant promptement aux interrogations du prestataire. ».
[4] Contrats Concurrence Consommation, n°10, octobre 2019 n°150
[5] Cass 1ère civ, 25 février 1997, n°94-19.685
[6] Cass. Com, 17 décembre 1991, n°90-13.557
[7] CA Paris, 17 novembre 2017, RG n°15/20024
[8] CA Limoges, 21 décembre 2015, RG n°14/01136
[9] CA Paris, 16 octobre 2015, RG n°13/06759
[10] Cass. Com, 11 janvier 1994, n°91-17.542
[11] CA Pau, 8 juin 1994, RG n°93/1324 : Le client doit s’impliquer, assumer et dialoguer avec le prestataire
[12] Cass. Com, 7 janvier 1997, n°94-16.558
[13] Cass. Com, 10 janvier 2018, n°16-23.790
[14] CA Aix-en-Provence, 2 mars 2017, RG n°13/22835
[15] Cass. Com, 19 février 2002, n°99-15.722