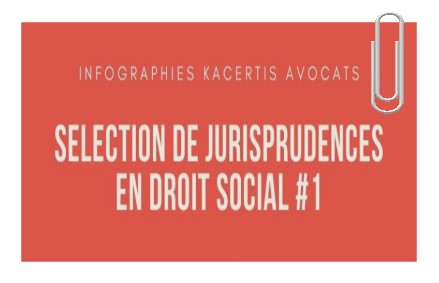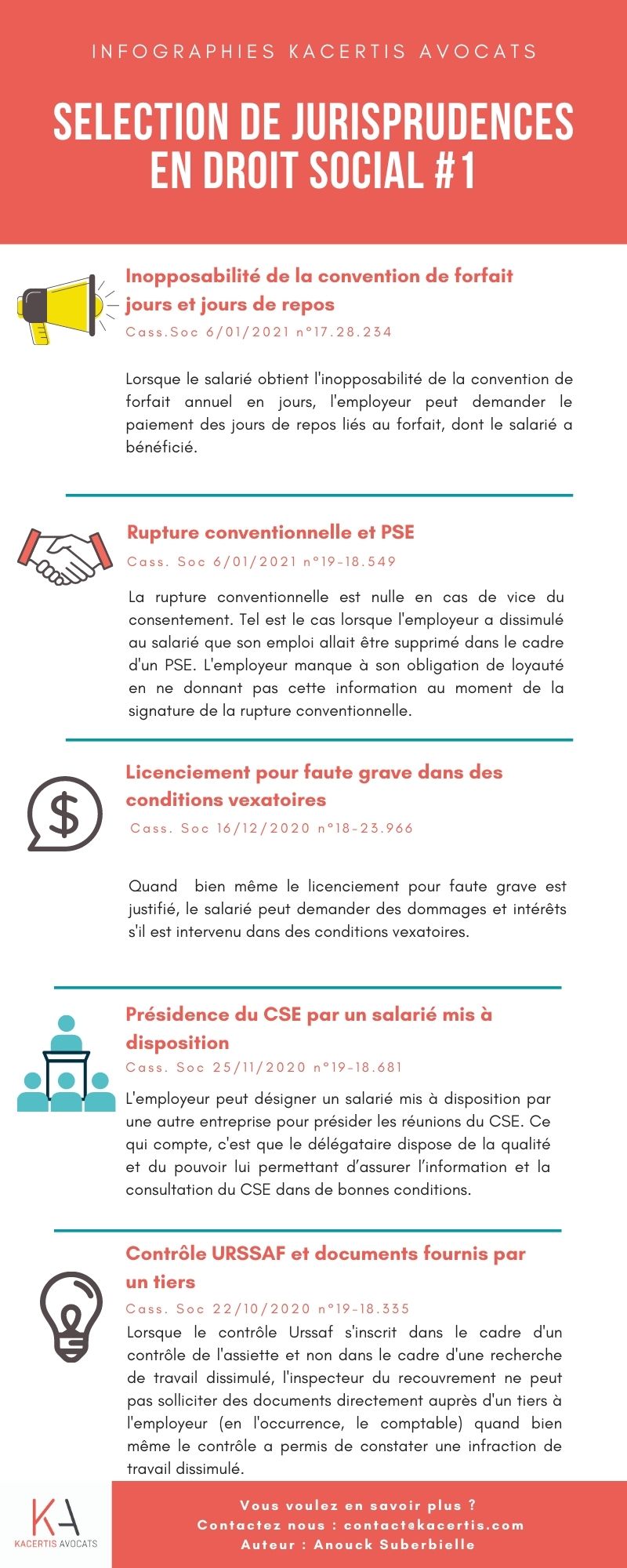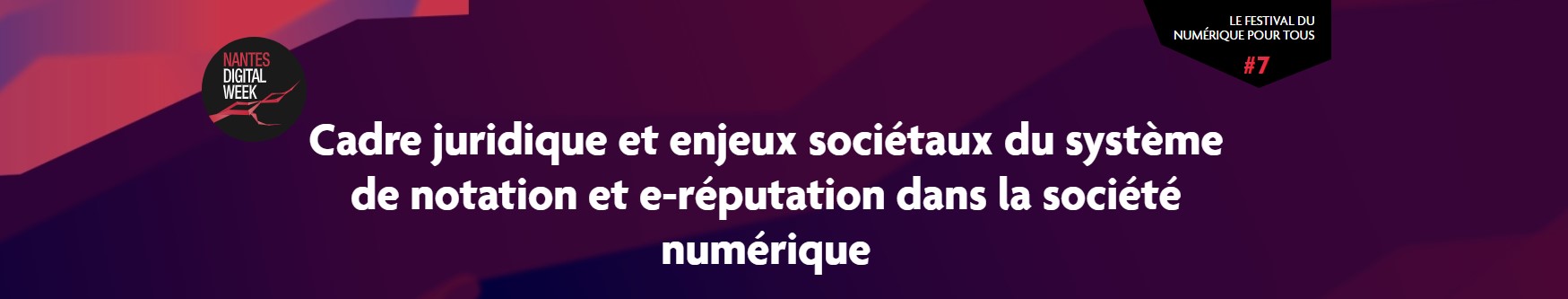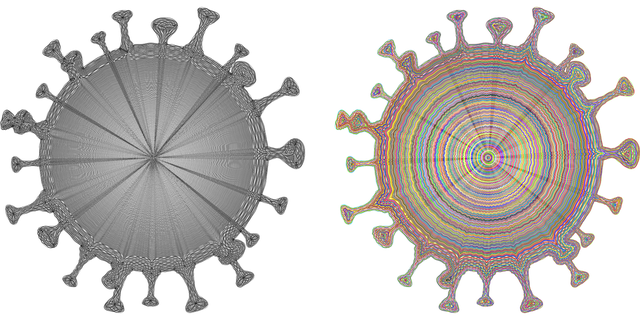Revirement de jurisprudence en matière de droit des marques : la seule demande d’enregistrement d’un signe, à titre de marque, ne constitue plus un acte de contrefaçon
Dans deux arrêts en date du 13 octobre 2021[1], n°19-20.504, la Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence en jugeant que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon au motif que ladite demande, « même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe.
De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. »
Autrement dit, le seul dépôt d’une marque ne peut plus constituer un acte de contrefaçon de marque.
La Cour de Cassation s’aligne ainsi, enfin, sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
En effet, la CJUE, dans un arrêt du 12 juin 2008[2], avait déjà précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :
- Un usage dans la vie des affaires, c’est-à-dire qui « se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (CJCE 12 nov. 2002, no C-206/01, Arsenal Football Club) ;
- Un usage effectué sans le consentement du titulaire de la marque ;
- Un usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
- Un usage qui porte atteinte à une des fonctions de la marque, sachant que sa fonction essentielle est de garantir aux consommateurs la provenance du produit/service.
Or, initialement et de façon constante, selon les juridictions nationales françaises le dépôt à titre de marque d’un signe constituait à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation (en ce sens voir par exemple : Cass, com, 26 nov. 2003, n° 01-11.784) et justifiait à lui « seul l’allocation de dommages-intérêts, peu important (…) l’absence d’usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante ».[3]
Dans l’arrêt examiné, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence en s’alignant sur la position de la CJUE et notamment sa décision Daimler en date du 3 mars 2016.[4]
Elle retient que la demande d’enregistrement d’un signe, à titre de marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon dans la mesure où elle ne caractérise pas [encore] un usage pour des produits ou des services, en l’absence de tout début de commercialisation, et ne cause aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque.
Ainsi, un demandeur, dans une action contentieuse, ne pourra plus solliciter – ou sera du moins mal fondé – à demander une réparation spécifique en raison du simple dépôt par le défendeur d’une marque qui serait de nature à porter atteinte aux droits afférents à la marque antérieure.
Notre cabinet reste disponible pour toute question et peut vous accompagner sur l’ensemble de vos problématiques en droit des affaires.
Morgane LE LUHERNE – Jérémy SIMON
Avocats
[1] Com. 13 octobre 2021, n°19-20.504 et 19-20.959
[2] CJUE, 12 juin 2008, aff. C-533/06
[3] Com. 21 février 2012, n°11-11.752
[4] CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, Daimler AG