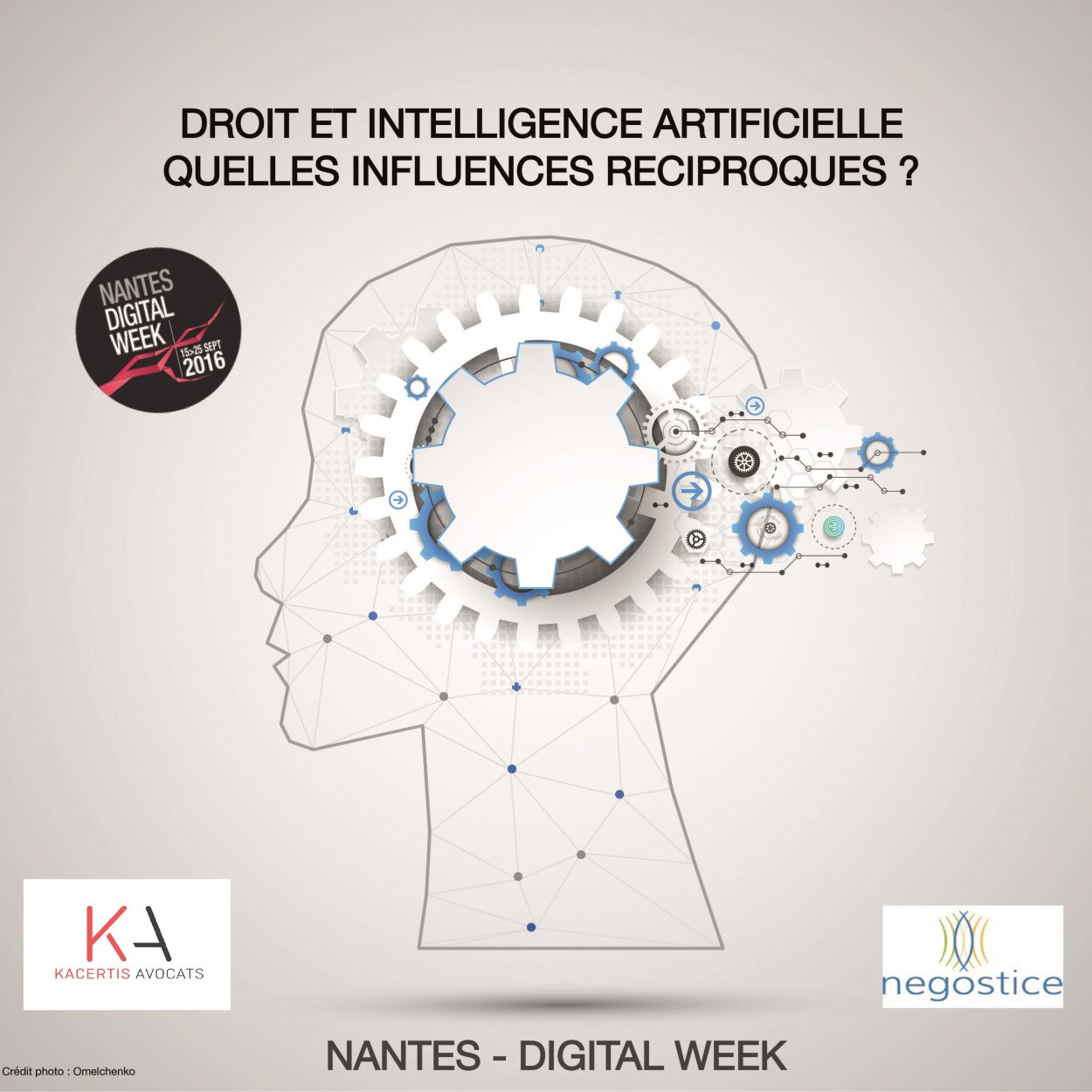Déposer une marque implique de ne pas agir de mauvaise foi.
Le 17 décembre 2012 un résidant portugais demande auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle) d’enregistrer la marque « NEYMAR » en particulier, pour des vêtements. La marque est enregistrée en avril 2013. Après avoir eu connaissance de cet enregistrement, Neymar Junior demande, auprès de l’EUIPO, la nullité de cet enregistrement en février 2016, laquelle est accueillie.
Le déposant portugais introduit alors un recours en annulation, contre cette décision de l’EUIPO, devant le Tribunal de l’Union Européenne.
Par son arrêt du 14 mai 2019[1], le Tribunal confirme cette annulation au motif que le déposant a agi de mauvaise foi[2], cette notion se rapportant à « une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielles ou commerciale. »[3]
En effet, le déposant portugais soutenait qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, il ignorait que Neymar Junior était « une étoile montante du football dont le talent était internationalement reconnu » (Rappelons qu’à cette date Neymar jouait au Brésil et arrivera en Europe avec son transfert au FC Barcelone en 2013). Le Tribunal, afin de rejeter cet argument, relève – de la même manière que l’EUIPO – que les éléments produits démontraient que Neymar était déjà connu en Europe à la date de la demande d’enregistrement de la marque.
La mauvaise foi était d’autant plus caractérisée que le déposant portugais avait déposé, le même jour, une demande d’enregistrement de la marque « IKER CASILLAS ». Manifestement le déposant n’avait pas qu’une connaissance limitée du football. La tentative de ce dernier de faire valoir qu’il avait choisi le signe « NEYMAR » en raison de la phonétique du mot et non pour faire référence au footballeur semblait bien vaine.
Le Tribunal écarte donc l’argument selon lequel ce choix aurait découlé d’une simple coïncidence.
Cet arrêt est aussi l’occasion de rappeler que l’enregistrement d’un signe en tant que marque, auprès d’un organisme de propriété intellectuelle (EUIPO, INPI, OMPI), et l’obtention d’un certificat d’enregistrement n’ont pas pour conséquence de faire acquérir au signe les caractéristiques de validité d’une marque.
Ce n’est pas parce qu’une marque est déposée et enregistrée qu’elle est pour autant valable et protégeable. La marque doit, en effet, pour être valable, être distinctive, disponible licite et non déceptive.
Le Cabinet peut vous accompagner dans le cadre de vos besoins en matière de propriété intellectuelle.
[1] Affaire Moreira T-.795/17 du 14 mai 2019
[2] Article 52 §1 sous b) du règlement européen n°207/2009, abrogé et remplacé par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
[3] T-795/17, §23