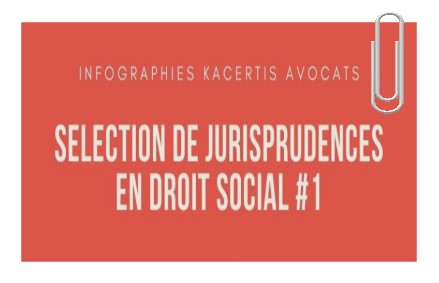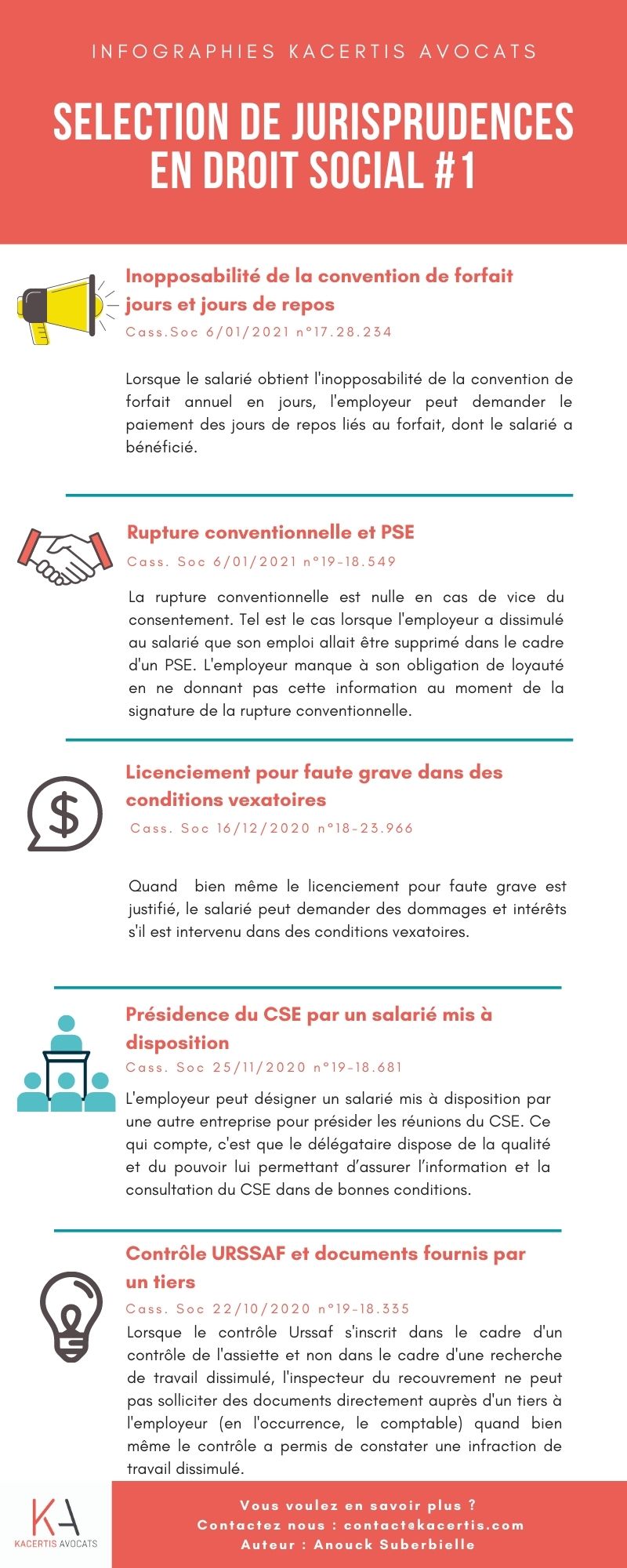Actualité n°1 – Droit au report des congés payés lorsqu’un arrêt pour maladie survient durant cette période
-
La question posée à la Cour de cassation :
Un salarié en arrêt maladie pendant ses vacances a-t-il droit au report des congés payés ?
-
La réponse de la Cour de cassation :
OUI
Cass. Soc 10 septembre 2025 (n° 23-22.732)
Le salarié, en arrêt maladie pendant ses vacances, peut désormais bénéficier d’un report de ses congés payés dès lors qu’il notifie son arrêt maladie à son employeur.
-
Le raisonnement de la Cour de cassation :
Il s’agit d’un revirement de la Cour de cassation basé sur le droit de l’Union Européenne, lequel consacre le principe du droit au report sur la base de l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE. Une évolution du droit français était attendue de longue date sur ce point.
La Cour de cassation distingue ainsi clairement deux droits n’ayant pas le même objet :
- Le congé payé : garantie du repos/ loisirs du salarié ;
- Le congé maladie : garantie du rétablissement/soin du salarié en cas de problème de santé.
-
Et en pratique :
Pour bénéficier d’un tel report, le salarié devra notifier son arrêt de travail à l’employeur ; les conditions de cette notification (forme / délais) ne sont pas fixées. Pour des raisons évidentes de preuve, le salarié devra privilégier le courrier LRAR ou le mail avec accusé de lecture.
Concernant les conditions du report, on peut supposer qu’il faudra se référer aux règles de report prévues par le code du travail (article L3141-19-1 et suivants).
Des questions pourraient néanmoins se poser en termes de prescription ou de traitement en paie. La question peut aussi se poser concernant la 5e semaine congés payés, puisque le Droit Européen n’en consacre que 4.
- Pour aller plus loin :
Cet arrêt s’inscrit dans une série de décisions importantes de la Cour de cassation sur les congés payés :
- Les arrêts pour maladie non professionnelle ouvrent droit à congés payés (Soc. 13/9/2023, n°22-17.340) ;
- Les arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle ouvrent droit à congés payés sans limite d’un an (Soc. 13/9/2023, n°22-17.638).
Actualité n°2 – Lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
-
La question posée à la Cour de cassation :
Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de congé payé ?
-
La réponse de la Cour de cassation :
OUI
Cass. Soc 10 septembre 2025 (n° 23-14.455)
| Les périodes de congés payés doivent être incluses dans l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires. |
-
Le raisonnement de la Cour de cassation :
Rappel : Les heures supplémentaires sont toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif de 35 heures par semaine dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail d’un salarié
Néanmoins, le droit français pose le principe du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en ne tenant compte que du travail effectif du salarié. Jusqu’à présent, les jours de congés payés étaient exclus.
La CJUE a cependant estimé, en 2022, qu’une telle règle produisait un effet dissuasif sur la prise du congé annuel et était donc contraire à la directive 2003/88/CE et à l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux.
Ainsi, le calcul des heures supplémentaires excluant les congés payés ou les congés maladie n’est pas conforme au droit européen.
La Cour de cassation s’est alignée sur le droit européen : le salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé des congés payés.
-
Et en pratique :
| Avant | Arrêt de la Cour de cassation du 10/09/2025 | |
| Lundi | Congé = 0 heure effective | Congé = 7 heures effectives |
| Mardi | 7 | 7 |
| Mercredi | 7 | 7 |
| Jeudi | 8 | 8 |
| vendredi | 8 | 8 |
| Temps de travail effectif | 30 | 37 |
| Temps rémunéré | 37 | 37 |
| Nombre d’heures majorées | 0 | 2 |
Vous avez une problématique à ce sujet ? Toute l’équipe du pôle social du cabinet est à votre écoute.
***
Anouck Suberbielle – Avocate associée – Spécialiste Droit du Travail – DU de Droit social des entreprises en difficulté
Mathilde Benoit – Avocate
Léa Brossay – Juriste apprentie