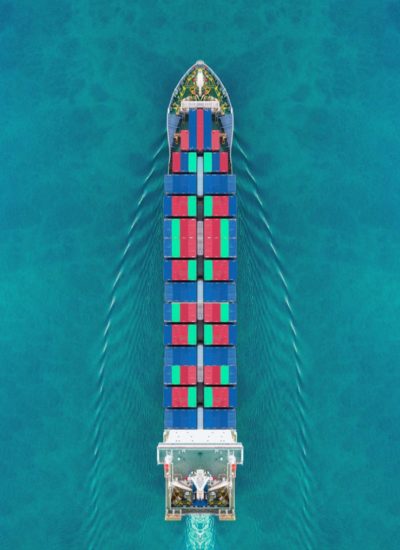La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n°23‑22.925), a jugé qu’au cours du contrat de franchise, « le franchisé peut […] accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente […] à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat ».
Cette position, très nuancée, offre matière à réflexion pour les franchiseurs : où s’arrête la liberté d’entreprendre du franchisé et où commence la protection juridique du réseau ?
Dans les faits, un franchisé d’un réseau d’assistance à domicile du groupe ORPEA avait effectué plusieurs démarches préalables à une activité concurrente (création de société, dépôt de marque, information client, publication sur les réseaux sociaux, etc..).
La question était donc de savoir si ces diligences pouvaient caractériser une violation de la clause de non-concurrence ou aux obligations de loyauté / bonne foi.
Résultat ? La Haute Juridiction répond par la négative et juge que seule la mise en œuvre effective de l’activité concurrente pouvait justifier une sanction. Peu importe la matérialisation par des actes préparatoires : tant qu’il n’y a pas d’exploitation, il n’y a pas violation.
Dans notre arrêt, aucun de ces actes — ni exploitation, ni recours à des moyens abusifs — n’a été retenu. Les seuls actes étaient préparatoires, dénués d’impact déloyal immédiat.
Cette décision jurisprudentielle illustre l’équilibre complexe à trouver chez le franchiseur : ce dernier doit protéger son réseau, son savoir-faire et sa clientèle, sans pour autant bloquer les ambitions raisonnables de ses franchisés.
En effet, un franchiseur trop strict = friction, contentieux, ambiance toxique.
MAIS à l’inverse, un franchiseur trop laxiste = affaiblissement du réseau, vide stratégique, images discordantes.
Bon à savoir : au-delà du contrat de franchise prévoyant des clauses de non-concurrence et de bonne foi, le droit de la concurrence déloyale sanctionne également toute manière de concurrencer sans loyauté, y compris dès lors qu’un projet est en gestation, par le biais :
- Du parasitisme : captation de clientèle, usage de secrets ou moyens du réseau sans autorisation ;
- Du dénigrement ou atteintes à l’image du franchiseur ;
- Des actes de désorganisation du réseau (ex. débauchage massif).
Alors, quels réflexes pour quelles situations ?
| Risque | Mesure adéquate |
| Actes préparatoires (premiers coups de communication, création juridique isolée…) | Réaliser une surveillance discrète et proportionnée |
| Suspicion d’une exploitation concrète | Engager rapidement une action juridique, notamment par le biais du référé |
| Exploitation concrète caractérisée | Saisir la juridiction compétente afin d’engager la responsabilité du franchisé, sur le fondement des clauses contractuelles et du droit de la concurrence déloyale |
En conclusion, la Cour de cassation protège donc la liberté d’entreprendre pendant l’exécution du contrat, tout en laissant ouverte la possibilité pour le franchiseur d’agir lourdement dès que l’activité concurrente est en cours. Un positionnement qui nous semble équilibré car il incite à définir des frontières contractuelles claires, tout en invitant à investir dans la fidélisation juridique et humaine du réseau.
Des questions sur la franchise ? Est-ce un modèle pour vous ? Vous rencontrez une situation litigieuse avec votre franchisé ? Le cabinet KACERTIS AVOCATS est à votre écoute.